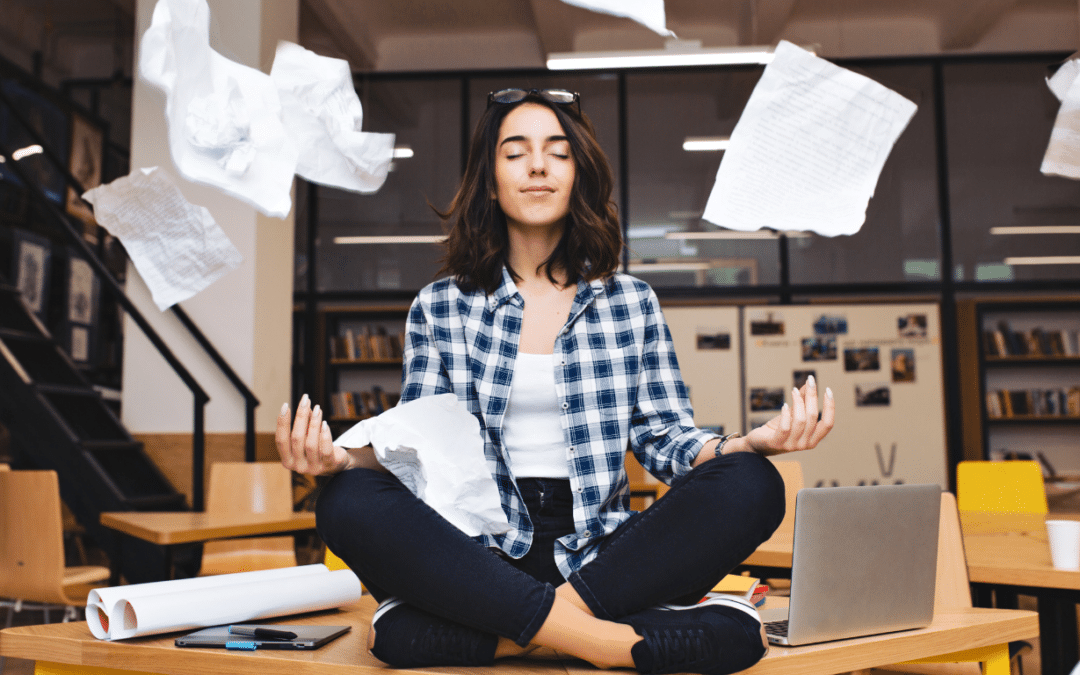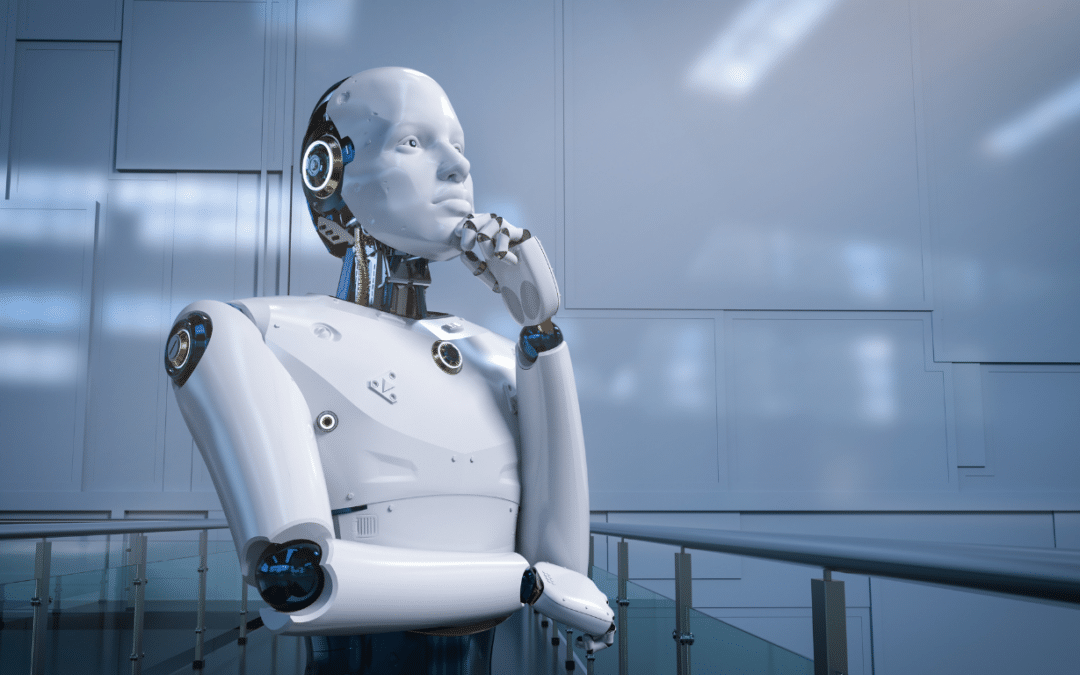Selon le rapport du Shift Project (2023), le numérique représente de 2 à 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce chiffre, en forte hausse, est principalement issu par la multiplication des services cloud, les flux et stockage massif de données, et l’usage intensif d’infrastructures IT. Cette situation appelle à une réflexion profonde sur la sobriété numérique et l’adoption de pratiques plus responsables.
En France, l’ADEME estime que les SI d’une entreprise représentent en moyenne 25 à 50 % de l’empreinte écologique numérique, soit bien plus que les postes de travail. Entre consommation d’énergie des data centers, renouvellement rapide du matériel, applications surdimensionnées ou logiciels non optimisés, les impacts sont multiples et encore mal maîtrisés.
Où en est-on vraiment aujourd’hui dans la cartographie et la prise en compte de ces impacts ? Et peut-on identifier des pistes de progrès réel qui en tiennent compte ?
Impact environnemental du numérique : les SI au cœur des enjeux écologiques
Les SI, victimes d’un système qui les dépasse ?
L’impact environnemental principal induit au SI ne leur est pas propre, il est en réalité lié à celui du numérique au sens large. La fabrication des équipements par exemple génère une majorité de l’empreinte carbone numérique. Pour l’Europe, cela constituerait de 54 % à 78 % de cette empreinte selon les sources. Pour mieux comprendre les enjeux globaux de la RSE, découvrez les idées reçues sur la RSE qu’il faut absolument dépasser.
Des ressources naturelles sous pression : le coût caché du numérique
En plus de la consommation d’énergie nécessaire à leur fabrication, ces équipements nécessitent des minéraux rares et polluants (lithium, cobalt, terres rares), souvent extraits dans des conditions écologiques et sociales qui posent question. Un comparatif qui illustre bien cette émergence de nouveaux besoins en minéraux est le nombre d’éléments du tableau périodique utilisés en période pré numérique vis-à-vis de celui utilisé aujourd’hui.
La problématique croissante des déchets électroniques et leur recyclage
Cette diversité de composants pose aussi des questions quant au traitement des DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques) qui de par leur complexité, sont plus difficiles à traiter. Ils nécessitent la mise en place de circuits de réemploi ou de circuits de recyclage tout aussi complexe, mettant à l’épreuve le célèbre adage de Lavoisier selon lequel « rien ne se perd, tout se transforme ».
En réponse à ces enjeux de déchets, on a pu voir apparaitre de nouvelles pressions réglementaires pesant sur les fabricants (ESPR, AGEC) comme sur les états eux-mêmes (directive Européenne WEEE). Un premier pas vers une forme de prise de conscience, mais qui démontre de quelle manière ces enjeux sont traités.
La consommation d’eau : l’enjeu méconnu des data centers
L’eau douce est également un sujet majeur du numérique, et au regard des enjeux actuels et futurs autour de l’eau, il pourrait en devenir le principal. Où se situe cette consommation ? Outre les besoins en eau liés à l’extraction de ressources et à la fabrication des matériaux, c’est dans le refroidissement des outils que continue ce cycle de l’eau du numérique.
Pour éviter les surchauffes, les data centers utilisent principalement deux méthodes de refroidissement :
- Le refroidissement par air, moins gourmand en eau, mais énergétiquement plus coûteux
- Et le refroidissement par eau via différents procédés, bien plus efficace, mais très gourmand en eau.
Outre l’impact des outils servant à l’utilisation des SI, les SI eux-mêmes ont un impact environnemental réel et palpable.
Le poids invisible, mais massif des systèmes d’information : la MBPI à la rescousse
Publiée après plus de 20 ans d’observation (2000–2023), elle dresse un état des lieux complet et précis de l’impact environnemental des SI, en s’appuyant sur des bilans carbones, des analyses de cycle de vie et des retours d’expérience publics et privés.
Des serveurs énergivores et sous-exploités
Le premier constat est celui des serveurs sous-utilisés. Par le biais des SI, les serveurs fonctionnent souvent en permanence, mais avec une utilisation très faible : en moyenne 5 à 15 % en environnements classiques, tandis qu’ils consomment jusqu’à 50 % de leur puissance maximale, même inactifs.
Du point de vue des hébergeurs, cela est nécessaire pour garantir une disponibilité continue des services, même en dehors des pics d’usage. Cette situation est renforcée par des infrastructures peu flexibles, un manque d’outils de gestion dynamique, une culture du “au cas où” dans les DSI, et une méconnaissance de leur coût environnemental. Résultat : des consommations d’énergie et d’eau élevées et constantes pour une utilisation plutôt variable.
Le « software bloat » : quand les logiciels s’alourdissent inutilement
Le deuxième est celui des « software bloat » qui désigne l’ajout de fonctionnalités, d’interfaces graphiques enrichies et de dépendances techniques, souvent sans lien direct avec les besoins réels des utilisateurs qui ne les utilisent pas ou peu. The Shift Project (2021) cite notamment Adobe Acrobat Reader. Conçu à l’origine pour lire des fichiers PDF, il est devenu lourd avec l’ajout de nombreuses fonctions peu utilisées (édition, cloud, signature, etc.), consommant plus de mémoire RAM et CPU que nécessaire pour une tâche aussi simple que lire un fichier PDF.
L’infobésité numérique : le problème du stockage excessif
Le troisième et dernier constat est celui de l’infobésité numérique ou plus concrètement d’un stockage mal piloté. Dans le cadre des SI, on estime que 40 à 60 % des données stockées en entreprise ne seraient jamais réutilisées. On parle parfois de “dark data” : des données stockées, mais inutiles ou inaccessibles, qui génèrent un impact environnemental caché.
Bien que tous s’accordent à dire qu’il est difficile de quantifier cette donnée, on peut avancer qu’à grande échelle, cette accumulation oblige à acheter toujours plus de capacité de stockage, renouveler les baies de serveurs, augmenter la redondance et mobiliser des infrastructures cloud coûteuses, parfois réparties à l’échelle mondiale.
Bilan écologique des SI : une double problématique
Pour résumer, d’un côté, les data centers, cœur énergétique du SI et autre matériel physique nécessaire à leur utilisation, sont gourmands en matière première, en électricité et en eau, et ce, sur l’ensemble de leur cycle de vie. De l’autre, de leur conception à leur usage, les Si eux-mêmes ne sont pas pensés pour être responsables.
Quelle réponse apportée par les entreprises dans leur démarche numérique responsable ?
Rationalisation des SI : vers une architecture plus efficiente
Certaines grandes ESN ont par exemple fait de la rationalisation du SI un des axes majeurs de leur stratégie, avec pour objectif général la réduction de l’impact de ses activités numériques. Cela passe par la cartographie de l’ensemble des applications en vigueur dans leurs outils, la suppression d’applications obsolètes ou sous-utilisées, la mutualisation des infrastructures et avec des partenaires ou encore une optimisation énergétique globale des services IT. Cette approche à deux objectifs : d’une part l’efficacité environnementale, de l’autre la réduction des coûts opérationnels, deux éléments souvent liés dans les stratégies de durabilité des organisations.
Éco-conception et Green IT : repenser le développement logiciel
D’autres proposent aussi des solutions Green IT pour réduire l’empreinte environnementale des SI. Cela permet d’optimiser la consommation des data centers via l’utilisation d’énergies renouvelables, de pratiquer l’éco-conception logicielle pour limiter le gaspillage des ressources, et d’accompagner les clients avec des audits et des plans d’optimisation.
Technologies vertes et data centers éco-responsables
De son côté, un éditeur comme Oracle intègre la durabilité au cœur de ses activités en développant des solutions cloud plus efficaces et éco-responsables. L’entreprise investit ainsi dans des data centers à haute efficacité énergétique, utilisant des technologies avancées et innovante de refroidissement (Evaporating cooling, free cooling, liquid cooling, etc) et des sources d’énergie renouvelable pour réduire leur empreinte carbone.
Sur les SI précisément, le groupe travaille dans une dynamique d’éco-conception afin d’optimiser ses logiciels pour améliorer leur performance et en limiter la consommation des ressources. En complément, Oracle propose des outils d’analyse et de reporting environnementaux s pour aider ses clients à mesurer et à réduire leur impact numérique. Car oui, agir sur ses pratiques est une étape importante, mais essayer de faire évoluer en parallèle, les pratiques de ses partenaires est fondamentales dans cette quête à la durabilité.
Des actions complémentaires donc, et qui abordent le sujet de manière multidimensionnel, traitant tant des usages que de la conception dans la limite des capacités d’actions des différents acteurs.
Le Green IS contre la dynamique de progrès
Du Green IT au Green IS : une approche systémique
Ces actions peuvent être catégorisées dans une logique de Green Information Systems (Green IS) qui désignent l’ensemble des systèmes d’information conçus, gérés ou utilisés dans une optique de réduction de l’impact environnemental. Contrairement au Green IT centré sur l’opérationnel, les Green IS englobent les usages, les processus métiers et les décisions qu’ils soutiennent.
Ils visent à aider les organisations à atteindre leurs objectifs de durabilité, par exemple en optimisant les chaînes logistiques, en réduisant les consommations d’énergie ou en pilotant les indicateurs RSE via la donnée. Autrement dit, il ne s’agit pas seulement de rendre les SI “moins polluants”, mais aussi d’en faire un levier actif de transformation écologique.
Les freins à la sobriété numérique en entreprise
Malgré cet intérêt et ces avancées, de nombreux freins subsistent. D’abord, et à l’image de nos modèles de consommation, la pression à l’innovation constante alimente une obsolescence très rapide : chaque nouveauté logicielle ou matérielle poussant inlassablement au remplacement de l’actuel déjà devenu ancien (et ce, même sans gain fonctionnel concret).
Ensuite, la complexité des systèmes d’information rend la cartographie de l’impact de leur usage difficile : multiples briques techniques, dépendances, et cloisonnement des responsabilités freinent les démarches d’analyse et de sobriété numérique.
Le paradoxe de la performance versus la durabilité
À cela s’ajoute un paradoxe de fond : on attend des SI qu’ils soient toujours plus puissants, disponibles, réactifs, alors même que la sobriété numérique impose de ralentir, mutualiser, et alléger. Ce décalage entre les objectifs business et les impératifs écologiques freine l’adoption de pratiques plus responsables, malgré les intentions affichées.
Nous nous retrouvons ainsi face à un choix de fond, qui dépasse le seul cadre des SI pour poser une question systémique : quel est le véritable coût de la performance ? Et surtout, ce coût correspond-il à celui que nous sommes réellement prêts à assumer ?
ESN et cabinets, agir à notre échelle ?
Gouvernance et stratégie : intégrer le numérique responsable dans la RSE
La réduction de l’impact environnemental des SI passe par leur intégration dans la stratégie RSE des organisations. Cela implique une gouvernance numérique responsable avec les directions IT, RSE, métiers et achats. Mesurer cet impact de manière précise et régulière est nécessaire pour arbitrer les choix d’outils et d’usage. Cette approche rejoint la nécessité de décliner la RSE au-delà du simple volet social, notamment dans les fonctions RH.
Formation et sensibilisation : cultiver la sobriété numérique
Former les équipes techniques à l’éco-conception et à la sobriété numérique devient également un levier clé pour faire évoluer les pratiques dès la conception des outils.
Partenariats et certifications : s’entourer d’acteurs engagés
Le choix de partenaires et technologies vertes alignés avec ces objectifs, en s’appuyant par exemple sur des certifications reconnues (Label numérique responsable, Green Hosting, etc.) mais aussi sur leurs pratiques, est également déterminant. Ces actions combinées permettent de concilier performance numérique et responsabilité environnementale portant même parfois le bénéfice dans une dimension financière. Les technologies comme l’IA peuvent également contribuer à cette démarche numérique responsable, comme le montre ce cas d’usage sur la projection stratégique RSE d’un parc immobilier grâce à l’IA. Ces outils, bien utilisés, permettent d’optimiser les ressources tout en atteignant les objectifs environnementaux.
Le Label Numérique Responsable : un engagement concret
En tant que cabinet en transformation digitale, SQORUS souhaite s’assurer que ses engagements et ses pratiques sont pleinement alignés avec sa volonté constante de progresser, tout en répondant aux enjeux de son environnement. Dans cette optique, le groupe a adopté en 2025 une démarche systémique, intégrant la notion de numérique responsable au cœur de sa culture d’entreprise, à travers l’obtention du Label Numérique Responsable.
Ce label, dispositif français lancé en 2019 par l’Institut du Numérique Responsable (INR) et l’agence LUCIE, distingue les organisations (entreprises, collectivités, ESN, etc.) engagées dans une démarche structurée visant à réduire l’impact environnemental, social et éthique de leurs pratiques numériques. Il repose sur un référentiel exigeant, articulé autour de cinq grands piliers : sobriété numérique, écoconception, inclusion et éthique, gouvernance responsable et durabilité des équipements.
Aux côtés de plus de 200 organisations déjà engagées, parmi lesquelles La Poste, MAIF, SNCF, Orange Business ou Monoprix, SQORUS s’inscrit ainsi dans une dynamique collective en faveur d’un numérique plus responsable.
SQORUS accompagne aussi ses clients sur le chemin de SI plus responsables. Si le sujet vous intéresse, contactez nos équipes.
« Le numérique peut être un formidable levier de transition écologique… à condition de le concevoir et de l’utiliser avec sobriété. » — Institut du Numérique Responsable (INR)
34 innovations et tendances RH pour 2025
Découvrez les dernières innovations et tendances RH et accélérez votre transformation digitale.
Un projet ? Une demande ? Des questions ?
Rejoignez une entreprise où il fait bon de travailler